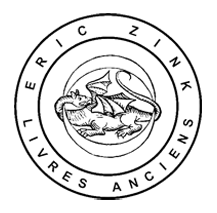
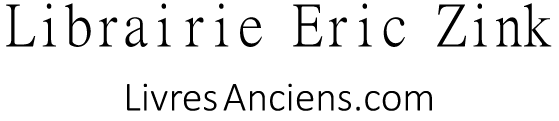
Physique
10000 €
9000 €
5500 €
4000 €
3500 €
3000 €
3000 €
3000 €
Vendu
2500 €
Vendu
2200 €
2200 €
1500 €
1500 €
1500 €
1500 €
1500 €
Vendu
1250 €
1200 €
1200 €
950 €
950 €
950 €
950 €
950 €
950 €
900 €
900 €
TVA intracommunautaire : FR87515091171
© Librairie Eric Zink Livres Anciens


















![Photo [VOLTA, Alessandro].](https://images.livresanciens.com/livres/200192/images/P1.jpg
)

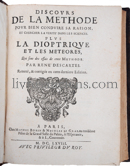

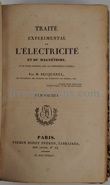


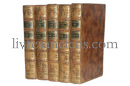








![Photo [LAMY, Dom Francois].](https://images.livresanciens.com/livres/203665/images/P3.jpg
)




