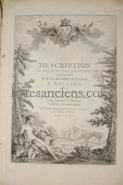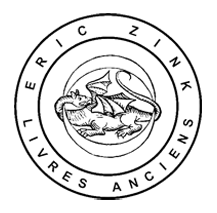
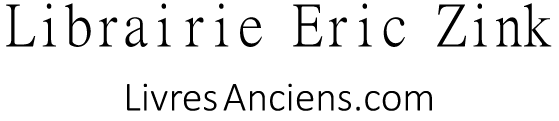
Résultats de votre recherche pour :
2500 €
2500 €
2500 €
2500 €
Vendu
2500 €
2500 €
2500 €
2500 €
2500 €
2500 €
2500 €
2500 €
2500 €
2500 €
2500 €
2500 €
2500 €
2500 €
2500 €
2500 €
2500 €
2400 €
Vendu
2200 €
2200 €
2200 €
2200 €
2000 €
2000 €
TVA intracommunautaire : FR87515091171
© Librairie Eric Zink Livres Anciens










![Photo [Chambre syndicale des forces hydrauliques].](https://images.livresanciens.com/livres/202915/images/P1.jpg
)

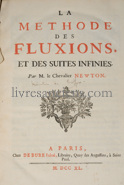


![Photo [SENAC, Jean Baptiste].](https://images.livresanciens.com/livres/203800/images/P9.jpg
)
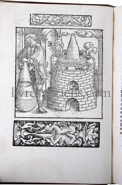



![Photo LEMNE, Levin [LEMNIUS, Levinus].](https://images.livresanciens.com/livres/203235/images/P3.jpg
)




![Photo [BELIN, Albert].](https://images.livresanciens.com/livres/2660/images/P1.jpg
)

![Photo [MANUSCRIT].](https://images.livresanciens.com/livres/202784/images/P1.jpg
)
![Photo [ASTRUC, Jean].](https://images.livresanciens.com/livres/203201/images/P5.jpg
)



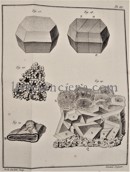



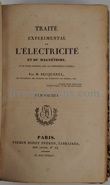
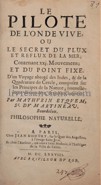
![Photo [REIBEHAND, Christophe].](https://images.livresanciens.com/livres/202878/images/P4.jpg
)